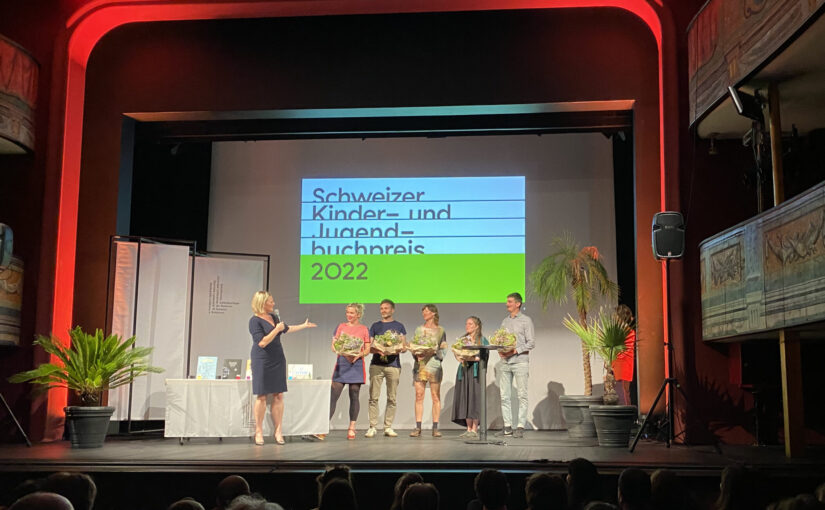Stéphanie Lux voit le jour à Thionville en France. Elle grandit ensuite en Lorraine où elle entre rapidement en contact avec la langue allemande. C’est durant son parcours universitaire qu’elle rencontre pour la première fois une traductrice. Rencontre qui la fascine. C’est ensuite tout un chemin qu’elle parcourt avant d’accéder à un premier emploi dans la traduction : du programme Goldschmidt qui change sa vie à ses premières traductions pour Gallimard. J’ai pu passer un moment privilégié avec cette traductrice pour discuter des enjeux autour de son métier, si important.
Vous êtes nées à Thionville, vous avez grandi en Lorraine et vous vivez désormais à Berlin. Le fait d’avoir vécu dans un pays francophone puis dans un pays germanophone vous aide-t-il dans la transmission (le fait de pouvoir transmettre) des valeurs qui seraient inclues dans les langues ?
Le français est vraiment ma langue maternelle. Cela fait vingt ans que je suis en contact avec l’allemand puisque j’ai étudié à Leipzig puis j’ai déménagé à Berlin, où je vis depuis 18 ans. Il est possible de pratiquer le métier de traducteur·trice depuis partout dans le monde mais j’ai fait le choix de m’installer dans le pays de la langue source. Je vois donc ce qui sort, travaillant également dans une librairie, ce qui rencontre du succès. Je suis toutefois moins en France, là où mes traductions sortent. J’ai moins de contacts avec les maisons d’édition françaises. C’est donc à double tranchant. Je m’efforce cependant de conserver mon français le plus en forme possible. C’est difficile de garder son niveau lorsqu’on baigne dans une autre langue. Mon métier est d’écrire en français, je dois donc être capable de produire des textes lisibles en français. Je me suis rendue compte lors de mes études à Leipzig qu’il n’était pas simple de garder un français correct. Mon ambition était de progresser en allemand, alors je me suis retrouvée à parler un français un peu bancal en revenant en vacances. La langue maternelle n’est pas forcément acquise et il faut toujours continuer à la travailler.
Vous êtes traductrice pour des auteurs que sont par exemple Clemens Setz, Michel Kölmeier ou encore plus récemment Julia Von Lucadou. Est-ce que vous pouvez développer quelque peu la relation entre un· auteur·trice et son traducteur ou sa traductrice ? Est-ce qu’il existe un droit de regard par rapport aux traductions ?
Alors les auteurs·trices n’ont pas de droit de regard à proprement parlé. Il y a un dialogue qui s’installe. Je pose mes questions aux auteurs ou autrices à la fin de ma première version, lorsque j’ai une vue d’ensemble du texte. Je n’ai pas envie de poser mille questions, je me tourne donc vers mes collègues germanophones. Ensuite, dans mon expérience, toutes et tous sont disposé·e·s à répondre à des questions, cela les fait parfois réfléchir à leurs choix dans le texte original. Comme nous le disions tout à l’heure en rencontre, il y a des choses qui passent en allemand au niveau du lectorat qui ne passent pas en traduction. Je vais poser des questions qui soulèvent des problèmes, qui montrent que certains termes sont trop flous ou vagues et où je dois prendre une décision. C’est très constructif comme échange, comme avec Julia von Lucadou, entre l’autrice et la traductrice.
J’ai eu la chance aussi, de côtoyer des auteurs·trices qui parlent également français. Ils et elles pourraient avoir un jugement, mais il ne suffit pas de parler français pour pouvoir juger de la qualité de la traduction. J’ai eu affaire à des auteurs qui m’ont laissée travailler librement, comme Clemens Setz. C’est très agréable d’avoir une certaine liberté pour travailler ces textes.
Comment s’effectue le choix d’un·e traducteur·trice pour une œuvre ? Est-ce un choix personnel des auteurs·trices ou est-ce que cela vient des maisons d’édition ?
Dans un premier temps, surtout dans le cadre d’un premier roman, ce sont les maisons d’édition qui prennent la décision. Ensuite, pour Clemens Setz, j’ai traduit deux de ses ouvrages, un roman et un recueil de nouvelles. Il s’agissait d’une proposition de la maison d’édition. Clemens avait déjà été traduit par quelqu’un d’autre, qui n’avait plus le temps de continuer à traduire en raison de projets personnels. J’ai traduit deux de ses titres puis j’ai été recommandée par l’auteur pour traduire une nouvelle parue dans une revue littéraire. Le contact est venu par la maison d’édition de Clemens qui m’a présentée comme sa traductrice.
Vous êtes donc en quelque sorte « freelance » par rapport aux maisons d’édition ?
Oui c’est ça, je suis toujours indépendante. Les contacts au sein des maisons d’édition rendent toutefois la relation un peu particulière. C’est un peu à l’image de la relation entre l’éditrice et l’autrice. Il faut également que la relation fonctionne humainement. Lorsque c’est le cas, les éditeurs et éditrices ont tendance à travailler avec les mêmes personnes. C’est plus simple de connaître la personne, de savoir comment elle travaille plutôt que de devoir s’ouvrir à une nouvelle façon de travailler.
Je vais désormais vous questionner un peu plus par rapport à la pratique de la traduction. Lors des « joutes de traduction », dans lesquelles vous avez participé hier aux côtés de Lionel Felchlin, une question très intéressante est apparue. Est-ce que le traducteur ou la traductrice lit l’œuvre en intégralité avant de commencer à la traduire ? Ou au contraire, est-ce que le traducteur se laisse surprendre par la découverte de l’œuvre ?
Alors généralement, je lis tout. Il m’est par contre arrivé à deux reprises de ne pas lire en avance. La première fois, c’était un thriller que je devais traduire. J’avais entendu d’autres collègues dire qu’ils ne lisent jamais le livre. Un thriller fonctionne bien pour ce genre de démarche. J’ai donc lu un premier chapitre, je l’ai traduit et j’ai continué ainsi. C’est quelque chose qui m’a vraiment portée car je voulais vraiment connaître la suite. Le suspense et la tension était tellement fortes qu’au bout d’un moment, à environ 2/3 du livre, je n’en pouvais plus. Il a fallu que le lise le reste du livre sans le traduire directement. C’est une bonne chose, car cela veut dire que le livre fonctionne.
Je suis actuellement en train de traduire une tétralogie de fantasy pour la première fois. Je traduis également au fur et à mesure. C’est peut-être plus facile pour de la littérature de genre, sans tomber dans les clichés l’opposant à la littérature classique. Par cette progression avec de la tension et du suspense, c’est un format qui s’y prête plus facilement. On verra si je continue ainsi ou pas.
Vous avez donc traduit des thrillers, des nouvelles et d’autres formats. Est-ce qu’il y a un genre que vous préférez ou un genre dans lequel vous vous retrouvez le plus ?
Alors je me concentre plus sur la littérature dite « générale ». Quand j’ai commencé à traduire, j’ai eu cette impression que, parce que j’avais traduit un polar et parce que j’avais fait un stage dans une agence littéraire qui représentait des auteurs de polar, j’étais cataloguée dans ce genre. J’ai aussi eu l’impression de devoir faire mes preuves avec de la littérature de genre avant qu’on me confie de la littérature générale. Ma bibliographie peut sembler assez hétéroclite, c’est un mélange entre des projets qui m’ont été proposés et des choses que j’ai apportées personnellement. Les projets que j’ai amenés moi m’intéressent le plus, mais c’est assez rare. Il m’est arrivé une fois de traduire un livre que je n’ai pas aimé, cela a été très difficile pour moi. Il faut toujours qu’il y ait une affinité avec le texte. Cela fait aussi découvrir d’autres domaines. C’est un métier où on apprend tout le temps, où on se forme tout le temps. Cela explique la largeur de la palette.
Quelles seraient les éventuelles limites qui peuvent apparaître dans le cadre d’une traduction. Je pense notamment au cas, également évoqué lors de la « joute de traduction », du « der, die, das » en allemand ou encore du « the » en anglais qui ne véhicule pas de genre. Comment parvenir à les traduire en français, est-ce que ce sont des choix personnels du traducteur ou de la traductrice ?
Il peut y avoir des discussions avec les auteurs·trices et les maisons d’édition. Nous ne sommes pas laissé·e·s seul·e·s avec les textes, mais on prend de toute manière des décisions. Il n’y a pas une seule traduction possible, ce dont le public n’est pas vraiment conscient. Le traducteur ou la traductrice peut interpréter les textes et aller dans une direction. Chaque langue a ses spécificités. Le problème qui m’intéresse depuis plusieurs années est celui du genre de la langue, ce qu’on en fait, ce qu’on pourrait en faire. Les maisons d’édition françaises sont assez frileuses par rapport à ce sujet et gardent par paresse ou par correction de la langue, par académisme, ce masculin générique, alors que d’autres maisons, plus petites et plus indépendantes, nous montrent qu’il est possible de faire différemment. Surtout dans le cas de textes militants, mais pas uniquement. Une grille de lecture supposément neutre, qui n’a de neutre que le nom, n’est pas obligatoire.
Vous avez également évoqué dans une conférence que même lors d’une traduction, vous utilisez vos propres mots et votre style. Comment est-il possible de s’affranchir du style de l’auteur ou est-ce qu’inconsciemment sa manière d’écrire est imitée ?
C’est vraiment un fil d’équilibriste. J’essaie de rendre justice au texte de départ, mais mon empreinte est toujours visible. Il y a une strate qui s’ajoute. Parfois je choque certain·e·s collègues ou le public en leur souhaitant de lire l’original. Nous sommes une sorte de béquille pour donner accès à un texte, mais rien ne vaut la lecture d’un original. Je donne une interprétation.
Je pense que pour certains auteurs·trices, qui ont un style littéraire très marqué, on essaie de se fondre dans le rythme de la phrase. Je respecte dans le texte si les phrases sont saccadées ou longues. S’il y a un parti pris esthétique très fort dans le texte, je vais le respecter. C’est vraiment un équilibre à trouver entre son propre style, ses tics de langage, les mots que nous n’aimons pas, les sonorités que nous préférons. Il faut essayer de ne pas être trop visible et, en même temps, montrer notre patte personnelle.
Je me pose aussi des questions sur mes traductions, comme le font les autrices. Après quelques années, je me dis que j’aurais probablement traduit un texte d’une autre manière. Une de mes traductions, faite il y a 4 ans, serait faite différemment aujourd’hui. C’est quelque chose qui change très vite. Ce sont les meilleures décisions possibles que nous avons pu prendre à un moment donné, mais ce n’est pas gravé dans le marbre. C’est pour cela que des retraductions ont lieu. Les traductions ne sont jamais neutres et ont peut-être tendance à vieillir un peu plus vite que les œuvres originales. Il y a en tout cas moyen d’en faire autre chose aujourd’hui, en mettant une autre perspective.
Est-ce qu’il peut arriver, pour des gros ouvrages, que plusieurs traducteurs soient mandatés et travaillent en cherchant un consensus ou est-ce que ce sont toujours des traducteurs individuels qui apposent leur propre style ?
Alors malheureusement ce sont des choses qui arrivent. C’est notamment le cas lors de coups éditoriaux où le livre doit sortir très rapidement après la parution originale. C’est quelque chose de commun pour les ouvrages anglais en allemand. Il faut que la traduction allemande sorte très rapidement, voire en même temps que l’original pour que les gens puissent le lire. Il existe plusieurs « best-sellers » qui sont traduits par deux, trois ou quatre personnes. Je n’ai jamais travaillé comme ça. J’ai l’impression que ce travail d’harmonisation doit prendre un temps fou, ce que les gens n’ont pas forcément dans un tel cas. Je me demande comment les gens font.
Peut être aussi que la traduction semble un peu plus « lisse », en raison de cet aspect de consensus de plusieurs personnes, sans forcément montrer une touche personnelle.
Oui, peut-être que ces personnes se mettent d’accord en amont sur des manières de travailler. Je n’ai jamais travaillé comme ça et je n’ai jamais lu, je pense, un texte qui a été traduit de cette manière. Je ne sais pas dans quelle mesure on se rend compte tout de suite, si on ne voyait pas les noms des traducteurs et traductrices au début. Le plus long livre que j’ai traduit était le roman de Clemens Setz qui fait mille pages. J’ai travaillé durant un an et je n’aurais pas voulu le partager avec une collègue ou un collègue. J’ai eu le temps de pouvoir travailler. C’était bien d’y travailler seule.