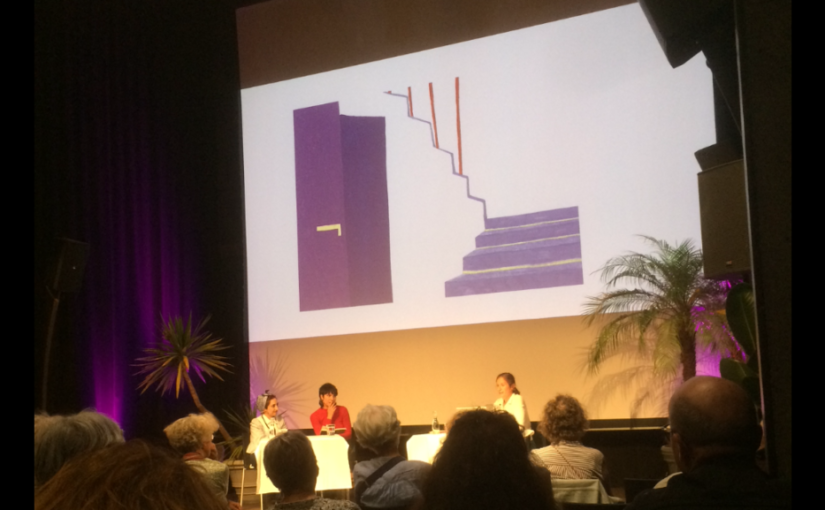On sait que tu es un adepte des contraintes poétiques et pour ce recueil, Législation dérobade, on a tout à fait compris que tu t’es amusé avec les structures de loi, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette structure ?
Alors la genèse, c’était écrire une loi avec un peu la systématique des lois, mais avec mon appréciation poétique. Dans l’écriture d’une loi il y a une logique, il y a des préambules, des machins, des trucs etc., jusqu’aux derniers articles qui sont transitoires parce qu’il faut modifier la loi. Donc il y a une certaine logique et je voulais essayer d’avoir cette logique-là.
Et puis à cela est venue assez naturellement s’ajouter, parce que c’est quelque chose dont j’avais envie depuis très longtemps, justement cette structure de texte que j’avais lue chez Aragon et chez Léo Ferré, où il y a un premier texte, puis après chaque phrase devient la première phrase des textes suivants. Et en cours d’écriture après – il y a sauf erreur 14 tableaux – je me suis dit qu’il fallait utiliser aussi la dernière phrase pour qu’elle devienne la conclusion, d’ailleurs c’est la seule partie intitulée « B », les autres c’est « A ».
Et puis en écrivant j’ai eu la vision de la tour de Babel, c’est-à-dire le premier texte c’est le socle, et puis après chaque phrase donne un truc comme ça. Le dernier texte, les phrases n’ont pas de sens l’une avec l’autre, c’est là où je dis que c’est une photographie vue du dessus, et on voit tout ce qui n’est pas terminé, tout ce qui n’est pas… voilà…, le dernier texte B si tu le lis comme ça sans tout le reste, ouais c’est de la poésie brute des surréalistes (rires), voilà. Donc la construction elle est venue en cours d’écriture, mais l’idée de cette contrainte, c’est quelque chose qui m’intéressait au niveau de la construction poétique.
Est-ce que tu avais écrit les articles avant et tu les as intégrés au poème ou au fur et à mesure, comment ça s’est fait ?
Ça s’est fait en cours d’écriture. J’avais l’intention de faire une loi qui traite du pouvoir, donc les premiers articles c’est « qui est le chef », puis on doit s’agenouiller devant le chef, puis après ça dérape un peu parce que le chef va être mangé par l’amante de la fille du chef. Et puis après, j’ai eu l’impression aussi en écrivant les textes, que la libellule et d’autres ont envie d’intervenir dans cette loi. Et puisqu’on a créé la loi et que le chef a été mangé, n’importe qui peut participer à la création de la loi.
C’est aussi un texte qui a été écrit sur plusieurs mois. Il s’est passé des choses et plus ça avançait, plus je me disais : c’est la nature qui va dicter sa loi. Et le dernier article dit en gros « il est illusoire d’interdire à la montagne de retourner à la mer ». Voilà. Donc on peut faire toutes les lois qu’on veut, la nature va décider pour nous.
D’ailleurs tu parles de la libellule moi je me suis demandé pourquoi la libellule ?
Dans la poésie de Milhit, il y a toujours plein d’animaux. Et pour moi c’est évident que les animaux pensent et font des choses, comme nous, comme l’être humain, et à la limite les arbres aussi, tout le monde participe à avoir une intention.
Et la libellule c’est un très très bel animal, c’est très très beau, c’est un insecte qui me fascine depuis longtemps parce qu’il y en a tout un tas de très différentes, et il y a des choses avec le corps qui est turquoise, il y en a des rouges, il y en a des vertes, mais il y en a des petites turquoises et quand elles s’accouplent ça fait un cœur, accrochées à un roseau… Et à part ça, la libellule vit trois quatre ans comme larve au fond de l’eau, elle bouffe plein de saloperies et puis quand elle sort de l’eau elle vit, je sais pas, un été ou quelques semaines – et en plus c’est très utile parce que ça bouffe plein de moustiques.
J’ai l’impression qu’en fait Législation dérobade c’est un cri de désabusement, enfin en tout cas j’ai senti beaucoup de rancœur, d’amertume, d’ironie ou de cynisme, et je me demandais s’il y avait encore de l’espoir et, si oui, de l’espoir en quoi ?
Il y a pour moi l’idée de l’âge, mon âge, je suis plutôt vers la fin, mais je suis dans l’état de la libellule, je suis juste dans le dernier moment où je peux voler (rires). La situation de la planète, la situation de la personne humaine qui est broyée par toute l’économie, par des lois qui disent que c’est interdit que…, qu’il faut que…, etc., donc l’avenir n’est pas très reluisant. Et puis en même temps c’est là depuis toujours, l’humain sur terre, c’est un petit bout, et c’est chaque fois des accidents, des catastrophes, des trucs comme ça qui font qu’on peut évoluer ou pas. Les survivants vont devoir s’adapter.
Alors c’est vrai que c’est un peu cynique. J’aime bien le mot « cynisme » plutôt que « désespéré », parce que finalement c’est pas moi qui vais décider ce qui est de l’espoir, ce sont les évènements, la vie qui va s’adapter ou pas. Les espèces qui disparaissent c’est une grosse perte, peut-être que ça va mettre en péril la personne humaine, mais il y aura toujours une vie, je crois que le soleil a encore 4 milliards d’années comme ça et puis après ça va s’éteindre donc voilà, mais je suis pas sûr d’être là ce jour-là parce que j’ai piscine (rires).
Donc, mon appréciation d’une situation un peu catastrophique finalement elle est pas importante. Je la dis parce que je la vis comme ça. Ce qui revient à comment ça a été écrit. J’ai commencé à écrire avec cette intention d’écrire une loi, et puis forcément cette loi s’inscrit dans la nature parce que je vis avec, je suis pas un citadin, je suis pas un bucolique, mais tout ce qui est dans la nature ça m’inspire, c’est l’image de ce qu’on vit nous. Et puis, j’ai commencé à écrire ce texte et après m’est tombé dessus un autre projet d’écriture qui était plus urgent, c’est Lettres aux gisants et pendant une année et demie j’ai écrit Lettres aux gisants et j’ai repris Législation dérobade, et puis après il y a eu, entre autres, cette pandémie qui est arrivée, donc on sent dans les textes vers la fin qu’il y a des interdictions, il y a des obligations, des trucs comme ça.
Est-ce qu’on peut déceler dans ton recueil une vision un peu absurde de l’existence, cette idée que rien n’a de sens ?
Un petit peu car la littérature, et notamment le théâtre de l’absurde, ça m’intéresse beaucoup, le langage est complètement en décalage. Donc il y a ce côté-là, et puis il y a le côté de « ce que je pense moi et ce que je dis moi, ça n’a pas beaucoup d’importance : je dis parce que j’ai envie de dire, j’écris parce que j’ai envie d’écrire. Je propose quelque chose, chacun prend ce qu’il veut ! ». Je n’ai pas d’explication à donner car je déteste les gens qui m’expliquent… J’ai à dire ce que je vois et puis si ça te parle tant mieux, et si ça te parle pas tu me diras comment tu vois le monde.
Mais il n’y a pas du désespoir, ça ne dit pas que c’est foutu ; autrement j’arrête d’écrire. Mais c’est que la situation n’est pas terrible et que je fais confiance à l’humain de manière général, à l’élan humain, pour sortir d’une situation de catastrophe.
Et as-tu déjà en tête l’idée de ton prochain recueil ?
C’est compliqué, parce que j’ai toujours plein de projets et, depuis hier que je suis à Soleure, j’ai déjà eu trois nouveaux projets d’écriture, donc il y a une sorte d’émulation ! (rires). J’ai plein de projets, mais après quand il faut les mettre en application c’est plus compliqué, alors certains projets ne restent même pas dans les tiroirs, ils disparaissent… Et puis la vie évolue, ce qui devient urgent et essentiel maintenant le sera peut-être moins dans une semaine. Alors il faut faire des choix et il y a quelque chose d’important pour moi et qui me prend la tête quand j’y réfléchis : j’ai l’âge que j’ai, à quel moment la cervelle va s’effriter, à quel moment je ne serai plus capable de faire une phrase ? Il faut que j’écrive maintenant.
D’un autre côté, je me pose la question : quelle légitimité j’ai d’aller bousiller des forêts pour faire du papier pour publier des poèmes ? Et en même temps j’ai envie (je ne dirai pas que c’est un besoin mais ça fait partie de mon ADN, de mon identité) d’écrire donc tant que c’est possible, je veux écrire ! Actuellement, je travaille sur deux projets d’écriture : il y en a un pour lequel je viens de trouver la première piste et je suis très content ! Ça va me demander six mois d’écriture.
Puisque je travaille sur des concepts, quand je commence mon projet, je sais qu’il est carré avec le début, la fin et la structure : ensuite je peux laisser aller ce qui vient. Mais je sais que la difficulté, en écrivant de la poésie, c’est que ça parte dans tous les sens. Donc je me suis dit à un moment donné qu’il fallait que je fasse un concept et une structure pour qu’ensuite ça me permette d’aller où je veux et de faire ainsi des choses concrètes qui ont abouti à un livre.
Donc c’est important pour toi d’avoir toujours une contrainte pour écrire ?
Oui, mais ça fait partie de moi. Ça s’inscrit un peu naturellement pour pouvoir me cadrer sinon je pourrais partir dans tous les sens. En plus, pour l’écriture, c’est intéressant car tu peux aller explorer le plus loin possible la contrainte précise.
Libre cours à ta voix : sur quel sujet qui te tient à cœur aimerais-tu prendre la parole ?
L’écriture ça doit rester en premier lieu un jeu et un plaisir. On a des textes qui existent depuis longtemps, qui nous expliquent comment on doit vivre, il y a des textes magnifiques qui nous accompagnent, moi je n’ai pas d’ambition d’aller sauver le monde et expliquer aux gens ce qu’ils doivent faire.
Donc ça doit rester un jeu, un plaisir, mais avec du sérieux. Ça doit être construit, ça ne doit pas être de l’usurpation de dire : « moi je sais écrire, alors j’écris et vous vous consommez, merde ».
A notre tour de nous prêter à un jeu poétique : si tu étais un vers de ton recueil Législation dérobade, lequel serais-tu ?
Je pense à un passage dans le recueil où je cherche des issues pour savoir comment ça va se passer et en fait je crois beaucoup à la révolte des mots. Je suis le fils d’un paysan qui a participé aux révoltes des abricots de 1953, mon père était très actif là-dedans et j’ai été conçu à cette époque-là, alors peut-être que c’est resté (rires). Je pense que le salut de toute l’humanité va se faire par une réaction du peuple pour dire NON. Alors il y a l’article dix-neuf du recueil qui m’est tombé dessus :
les allumettes sont des armes de destructions massives
la cervelle des gens est une surface abrasive
C’est par l’imaginaire, par le cerveau et les idées des gens qu’on va pouvoir gratter l’allumette et foutre le feu !
Si vous souhaitez à votre tour rencontrer l’auteur, rendez-vous à Mase samedi 4 juin à 11h pour le vernissage de sa nouvelle publication Lettres aux gisants.
Et pour retrouver l’ensemble de ses publications :
Pierre-André Milhit – Littérature, Écrivain, Poète – Sion (culturevalais.ch)