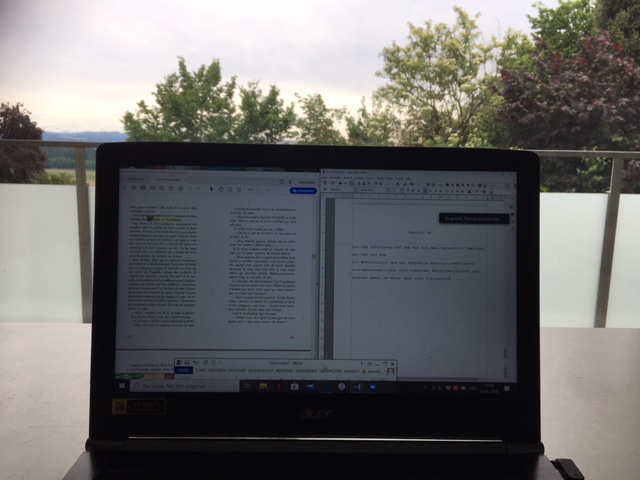Le voyage intime des traducteurs de Philippe Rahmy

Les choses continuent d’exister quand nous ne sommes pas là. Il suffit de les disposer avec soin pour que les autres les trouvent belles et s’en servent en notre absence. Écrire. Que sont les livres sinon la chambre vacante d’un écrivain parti en voyage dans ses histoires ?
(Philippe Rahmy, Béton armé)
En effet, les écrits de Rahmy, disposés avec soin ont su plaire. Luciana Cisbani, traductrice d’Allegra parle d’un coup de foudre de lecture, qui a déclenché l’envie de traduire le roman en italien. De même, Yves Raeber s’est beaucoup investi dans la traduction de Béton armé en allemand.
Les deux traducteurs de Rahmy n’ont pas connu Philippe personnellement. Pourtant, ils le nomment par son prénom, parlent de lui comme d’un ami proche, de ses souffrances et de sa maladie, de la corporalité et du mystère de ses livres.
Même s’il s’agit d’un auteur comme Rahmy, qui invite ses lecteurs chaleureusement à vivre en intimité avec ses livres, on peut s’interroger sur la possibilité et les limites de connaître quelqu’un à travers son écriture.
Traduire permet de faire revivre un écrit, de le faire survivre. La traduction construit un pont qui permet au texte de dépasser son cadre original. Or, dans un premier temps le traducteur doit envisager le voyage dans le sens inverse, c’est-à-dire il lui faut enjamber le fossé là où il n’y a pas encore de pont. Un saut dans le vide, là où le traducteur suppose un fondement fécond du texte. Sur les traces fictionnelles de Béton armé, Yves Raeber a entrepris un voyage à Shanghaï. Pour rédiger Die Panzerung, il s’est plongé dans le décor dans lequel le livre original a vu le jour. Incontestablement une telle expérience crée de la proximité et accentue l’empathie du traducteur pour l’auteur. Néanmoins, cette proximité peut être trompeuse. Elle est construite unilatéralement et repose sur les dispositions et sensibilités personnelles du traducteur. C’est dans ce sens que Luciana Cisbani nous rappelle que le traducteur est amené à faire des choix et qu’il doit supporter que les autres possibilités ne se taisent jamais.