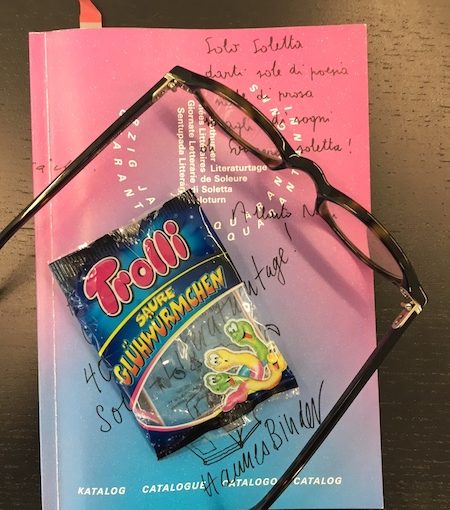« Si, comme le Vésuve à Pompéi, Fessenheim avait été un volcan, c’est dans cette frénésie immobile que la nuée nous aurait tous saisis. » Les cendres auraient matérialisé l’ampleur de la radioactivité, invisible conséquence de la catastrophe nucléaire.
C’est d’une certaine manière ce qui s’est produit aujourd’hui midi, au Stadttheater de Soleure. Le programme annonçait « Thomas Flahaut – Lecture musicale ».
La solitude habituelle de la lecture a fait place à la multitude, et le silence au bruit : la voix de Thomas, la guitare d’Antoine, son frère, et les spectateurs réunis pour les écouter. Ostwald, pour l’occasion, devient Quitter Pompéi, plus poétique, plus musical dirons-nous. Les répétitions, les reprises que l’écrit a tendance à condamner y sont mises à l’honneur. La lecture de Thomas les appuie et les nuance, leur donne une dimension nouvelle, déconstruit par moments la phrase pour la reconstruire plus tard, au rythme de sa main qui – comme un chef d’orchestre – ne cesse de battre la mesure.
En plus de se matérialiser sur la scène, le texte se transforme en dialogue. La guitare s’arrête par instants et laisse résonner les mots, seuls. D’autres fois, c’est l’inverse. D’autres fois encore, les deux coexistent et composent un texte inédit, renforcé par la collaboration des mots et des notes.
Les mains d’Antoine courent sur le manche de sa guitare électrique. Elles l’abandonnent parfois un instant et s’approchent du sol, bidouillent l’une des nombreuses pédales d’effet qui jonchent les pieds du musicien, puis regagnent les cordes. Ce va-et-vient est loin d’être anodin. Mieux que ça, il est essentiel. Tantôt il mime le monde, reproduisant le hurlement de l’alarme annonçant l’évacuation de Belfort ; tantôt il construit l’espace, prend le relais de l’imagination du lecteur et figure, musicalement, l’ambiance apocalyptique d’un Est français catastrophé.
Quelques incidents techniques ponctuent la performance des frères Flahaut. La balance des volumes n’est pas optimale, des interférences venues d’on ne sait où perturbent l’uniformité du son, quelques larsens se font entendre. Thomas s’arrête, énervé, la tension est palpable. Il demande à l’ingénieur du son de faire quelque chose, reprend sa lecture ; la tension demeure. C’est alors que je me rends compte de ce qui vient de se passer. Dans le microcosme du Stadttheater de Soleure, la micro-catastrophe technique vient de reproduire, toutes proportions gardées, la catastrophe de Fessenheim. Le public est irradié et c’est dans un climat post-apocalyptique – le meilleur possible – que retentiront désormais les mots de Thomas Flahaut.